Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport et membre associé du Centre de Recherches Pluridisciplinaires Multilingues (CRPM) à l’université Paris-Nanterre, et Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport et enseignant à Sciences Po Paris, viennent de publier aux éditions Tallandier La Guerre du Sport, une nouvelle géopolitique, un ouvrage complet qui met en lumière l’influence des grands enjeux internationaux sur un un monde du sport à l’apolitisme de plus en plus illusoire. Nous vous en proposons ici quelques extraits consacrés à l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur l’univers sportif de ces deux pays… et au-delà.
Cet article est cité dans l’émission « Accents d’Europe », sur RFI, dont The Conversation France est partenaire
L’impossible apolitisme du sport mondial face à la guerre en Ukraine
À la suite de l’invasion du 24 février 2022, des organismes tels que le CIO, l’UEFA et la Fifa appellent rapidement à l’exclusion de la Russie du monde du sport. En conséquence, le 5 mars, 37 nations dirigées par le Royaume-Uni signent une déclaration conjointe interdisant à la Russie et à la Biélorussie d’organiser ou de se voir attribuer des événements sportifs internationaux ou encore d’y soumissionner. Parmi les signataires, des pays principalement occidentaux tels que la France, l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis et le Canada se positionnent en faveur de sanctions à l’encontre de la Russie. Cette déclaration est catégorique : « La guerre non provoquée et injustifiable de la Russie contre l’Ukraine, soutenue par le gouvernement biélorusse, est répugnante et constitue une violation flagrante de ses obligations internationales. » Ainsi, du point de vue sportif et diplomatique, la Russie se retrouve isolée.
[…]
La création d’un nouvel ordre mondial du sport ?
Dans les paroles et les actions, le pouvoir russe privilégie depuis le début de l’invasion la création d’un pôle sportif alternatif à l’échelle mondiale pour contrer les institutions sportives internationales traditionnelles telles que le CIO ou la Fifa.
En pratique, cela impliquerait de se passer du sport mondial, de le remplacer ou de rivaliser avec lui. En Russie, par exemple, l’idée de diviser le mouvement olympique gagne du terrain. Il s’agirait de séparer les Jeux en deux parties : à l’Ouest, les Jeux occidentaux, et à l’Est, les Jeux russes « traditionnels ». Ces Jeux à la russe se dérouleraient en été en Crimée et en hiver à Sotchi. Ils puiseraient leur légitimité dans les liens historiques plus ou moins confirmés de ces régions avec la Grèce antique. En 2007, pour obtenir les Jeux de Sotchi, Vladimir Poutine avait rappelé aux membres du CIO que « les Grecs anciens ont vécu près de Sotchi. J’ai vu le rocher près de Sotchi où, selon la légende, Prométhée était enchaîné. Prométhée qui a donné le feu aux hommes, le feu qui est finalement la flamme olympique ». Depuis, l’argument du mythe est souvent utilisé pour évoquer cette région russe, composée du Caucase et de la péninsule de Crimée. Selon Vladimir Poutine, ces terres sont sacrées et pourraient servir de cadre à un nouvel ordre mondial du sport.
Dans le cadre de ce scénario et pour rivaliser politiquement et sportivement avec succès avec le mouvement olympique, le pouvoir russe cherche déjà des alliés […]. L’objectif est de solliciter les pays membres de la CEI, de l’Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS pour qu’ils participent à cette ambition. Ces trois organisations regroupent plusieurs acteurs majeurs du sport mondial, parmi lesquels la Chine occupe une place de choix. Si ce projet russe réussissait, il pourrait donner naissance à un nouvel ordre mondial du sport destiné à rivaliser avec les institutions historiques du sport moderne telles que le CIO ou la Fifa. Concomitante à une dynamique plus générale de désoccidentalisation du monde, cette influence dépasse très largement le cadre sportif.
Le sport ukrainien, c’est la guerre avec les balles
Depuis le 24 février 2022, pour Volodymyr Zelensky et l’Ukraine, le sport, c’est la guerre avec les balles. En effet, à l’heure du conflit russo-ukrainien, le domaine sportif en Ukraine a subi une transformation significative.
Initialement, au lendemain de l’invasion et sur une période de moins de deux mois, les autorités nationales ont suspendu l’ensemble des activités sportives en Ukraine. L’accent était alors mis sur l’effort de guerre, et les installations sportives ont été utilisées par les militaires ukrainiens comme bases de repli ou de déploiement. Cela explique pourquoi les installations sportives, telles que les stades ou les gymnases, sont souvent la cible des forces russes, car elles pourraient potentiellement abriter des unités ukrainiennes entières.

Par la suite, lorsque l’armée russe a commencé à faire du surplace voire à reculer sur le terrain, le secteur sportif ukrainien a pris une nouvelle orientation. Certains clubs de football ont obtenu la permission de jouer des matchs de charité à l’étranger, malgré la loi martiale interdisant aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le territoire. Ces matchs visaient à sensibiliser à la cause ukrainienne. De même, les athlètes en préparation pour d’importantes compétitions ont pu s’entraîner à l’étranger.
Par exemple, l’équipe nationale de football a été autorisée à s’entraîner en Slovénie pendant un mois en mai 2022 en vue des qualifications pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Ainsi, le soft power sportif a contribué symboliquement à l’effort de guerre. Les autorités estimaient qu’un athlète ukrainien était plus utile sur le terrain sportif que sur le front militaire. Selon elles, il offrait un double avantage en donnant à l’Ukraine une visibilité internationale et en pouvant potentiellement rehausser le moral des troupes déployées sur le terrain. Cette dimension ne doit pas être sous-estimée : une victoire sportive pour un athlète ukrainien procurait aux soldats, qui suivaient régulièrement les matchs et les résultats, un certain espoir et un regain de moral.

À partir de la mi-juin 2022, le sport à l’échelle nationale a progressivement retrouvé sa place, bien que dans des conditions exceptionnelles. Par exemple, la Première Ligue ukrainienne de football a obtenu l’autorisation de débuter la saison 2022-2023 fin août. Toutefois, les règles ont été adaptées à la situation du moment. Les spectateurs ne sont plus autorisés à assister aux matchs, et ceux-ci nécessitent une autorisation systématique de l’administration militaire pour avoir lieu. Si une alerte de raid aérien potentiel retentit dans un rayon de moins de 500 mètres, le match est interrompu et les joueurs se réfugient dans les vestiaires, ce qui se produit régulièrement. Après un an et demi de guerre, aucun footballeur ukrainien n’a été blessé. Cependant, certains matchs ont duré plus de cinq heures au total.
Paradoxalement, l’Ukraine continue de participer activement aux événements sportifs européens et mondiaux. Chaque compétition internationale offre l’opportunité aux autorités de promouvoir les intérêts du pays dans un contexte de guerre. De plus, certains clubs ukrainiens sont accueillis par les alliés géopolitiques les plus proches de l’Ukraine. Par exemple, le Dynamo Kyiv s’entraîne et joue certains de ses matchs à Cracovie, en Pologne. Dnipro, quant à lui, joue et s’entraîne à Košice, en Slovaquie, de manière permanente. En général, de nombreux athlètes et entraîneurs ukrainiens, actifs ou non, ont choisi de rejoindre le front dans l’est de l’Ukraine, mettant leur carrière en suspens. Le cas emblématique est peut-être celui de Yuriy Vernydub, entraîneur ukrainien du Sheriff Tiraspol, qui est parti au front dès le lendemain de l’invasion. Il est important de noter que ces professionnels du sport proviennent souvent de divisions sportives moins importantes. En effet, les athlètes de renom préfèrent généralement contribuer à l’effort de guerre d’un point de vue sportif et symbolique.
Le cas des supporters des clubs ukrainiens est également notable. Depuis 2014 et surtout depuis l’invasion russe en Ukraine, de nombreux ultras ont rejoint le front pour combattre ensemble, mettant de côté leur rivalité sportive. En temps de paix rivaux, les supporters du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kyiv combattent ensemble contre leur ennemi commun.
La stratégie politique et sportive de Volodymyr Zelensky après l’invasion russe
Depuis le 24 février 2022, la stratégie internationale de Volodymyr Zelensky s’est intensifiée dans le domaine sportif, trouvant écho dans l’espace médiatique mondial. Les ministères, les organisations privées et le comité olympique ukrainien, tous les organes politiques, économiques et sportifs du pays sont mobilisés pour transmettre un message : l’exclusion de la Russie doit durer tant que l’invasion se poursuit.
Le hashtag #boycottrussiansport en est devenu le symbole. De manière concrète, les arguments ukrainiens peuvent être résumés en cinq points. La Russie devrait être exclue des événements sportifs mondiaux et des Jeux olympiques de Paris 2024 car elle est un État envahisseur et terroriste ; les athlètes russes sont de quelque manière liés à l’État russe ou à l’armée russe ; le régime de Vladimir Poutine exploite le sport à des fins de propagande ; dans de telles conditions, l’équité des compétitions sportives (Jeux olympiques, Coupe du monde, etc.) ne peut être maintenue ; les athlètes ukrainiens perdent la vie au front ou ne peuvent pas s’entraîner convenablement pour les grandes compétitions internationales, par conséquent la Russie et la Biélorussie ne devraient pas être autorisés à y participer.
Pour diffuser ces arguments, le gouvernement ukrainien utilise divers canaux. Tout comme Volodymyr Zelensky utilise son smartphone pour communiquer avec différentes générations, les principaux porte-parole du sport ukrainien exploitent les canaux et les codes contemporains pour diffuser leur message. Les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook ou Instagram sont fréquemment utilisés pour diffuser des propos politiques liés au sport. On peut souvent voir circuler des vidéos de quelques secondes transmettant un message percutant. Par exemple, l’une de ces vidéos virales montre un athlète russe lançant un javelot dans les airs. Le javelot se transforme ensuite en obus, suit la trajectoire de l’athlète et finit par s’écraser sur un bâtiment ukrainien. Un message s’affiche alors à l’écran : « Boycott Russian Sport. »
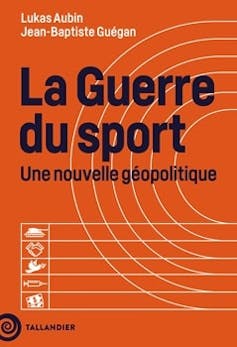
En général, tous les médias sont utilisés par l’Ukraine pour défendre ses intérêts. Par exemple, le site web du ministère ukrainien de la Jeunesse et des Sports est en ukrainien, mais une bannière en gras et en anglais apparaît en haut de la page, indiquant : « Russian and Belarusian athletes who support the war in Ukraine. » la bannière, les internautes ont accès à une liste d’athlètes russes et biélorusses soutenant officiellement l’invasion russe en Ukraine. Le compte Facebook du ministère suit la même approche, avec une bannière principale affichant à nouveau le hashtag #boycottrussiansport, cette fois-ci en lettres sanglantes.
Pour avoir un impact encore plus fort, le Comité des sports d’Ukraine (SKU), chargé de promouvoir le développement des sports non olympiques, a lancé le projet Angels of Sport via un site web recensant les athlètes et entraîneurs ukrainiens professionnels décédés au combat depuis le 24 février 2022.

